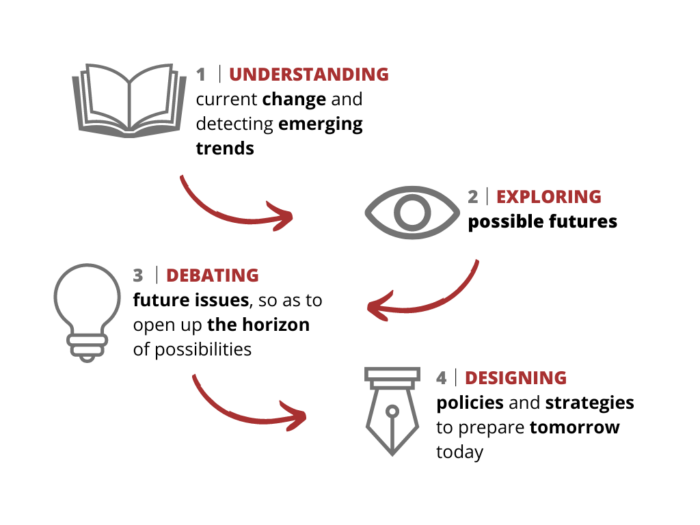Pour le citoyen ordinaire que je suis, comme sans doute pour beaucoup de nos lecteurs, l’abondante production d’essais sur l’État, particulièrement en France, est une source de perplexité permanente. Et la publication récente, sous la direction de Roger Fauroux et Bernard Spitz, de la somme Notre État (Paris : Robert Laffont, 2000), oeuvre collective d’une trentaine de ses grands commis (repentis ?), n’est pas de nature à dissiper l’impression étrange que confère cette littérature produite depuis 20 ans qui, dans l’Hexagone, me semble particulièrement confuse et quelque peu désespérante.
Partout, du moins dans les pays industrialisés, la réforme de l’État est à l’ordre du jour : en Australie comme en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis comme au Canada, en Grande-Bretagne comme en Suède, parce que dans tous ces pays est posé, comme en France, le problème des missions imparties à l’État, de son efficience, du périmètre et de l’efficacité de ses interventions. Et dans nombre de ces pays, sans que l’on converge vers un modèle unique, des réformes en profondeur sont en effet intervenues.
Je sais que l’on est souvent mauvais juge de ce qui se passe dans son propre pays, souvent trop prompt à dénigrer les siens et à considérer le succès des autres. Mais il me semble que l’on assimile en France, sous le vocable d’État – auquel sont aussitôt associés les qualificatifs d’obèse et d’opaque – trop de choses différentes.
Il me semble que diverses questions se posent. D’abord, celle de nos institutions publiques – je préfèrerais dire politiques – qui est particulièrement complexe en raison de la multiplication des niveaux, de l’enchevêtrement des compétences – enjeux de pouvoir -, et de leur redéploiement. Ici interviennent évidemment le processus inachevé de décentralisation et l’édification, aux niveaux infra et supranational, d’institutions nouvelles, sans véritable réflexion, ni philosophico-politique ni constitutionnelle.
Différente est ensuite la question de l’administration publique (et/ou des services publics) qui constituait jadis une sphère distincte, peut-être parce que la haute administration disposait d’une autonomie plus large vis-à-vis de la sphère politique, et que la confusion n’était pas si grande entre le fonctionnaire et l’élu. Le mélange des genres auquel nous avons assisté depuis 30 ans en France, au détriment, du reste, de l’élection de simples citoyens aux fonctions politiques, me paraît éminemment nuisible au bon fonctionnement et de l’administration et de la démocratie.
À lui seul, ce problème de la distinction entre le service public et les institutions politiques est, à mon sens, essentiel et trop peu abordé. À chacun son rôle et son métier. À chacun son statut et sa responsabilité : ici, ceux du manager, là ceux du politique. Pourquoi avoir honte des uns ou des autres et confondre les deux au détriment des fonctions fort respectables dévolues à chacun ? Au détriment des élus à qui il incombe d’incarner une vision du bien commun, celle-ci empruntant au registre des valeurs, élus qui se doivent, une fois promus par le peuple aux fonctions suprêmes, d’être les garants d’un futur démocratiquement érigé au rang de souhaitable. Au détriment des fonctionnaires auxquels sont dévolues des fonctions plus pérennes et moins sujettes à polémique bien que, reconnaissons-le, leur périmètre puisse, lui aussi, évoluer au fil du temps.
Certes, en commun, l’élu et le fonctionnaire incarnent le bien public. Ni l’un ni l’autre ne sont donc à l’abri d’une réflexion nécessaire sur les finalités de leurs fonctions. Mais de là, précisément, vient mon sentiment que le débat tourne en rond, que la littérature sur l’avenir de l’État est désespérante car, omettant soigneusement de s’interroger sur les finalités qui sont les siennes, l’attention est tout entière portée sur ses instruments, ses modalités d’action, ses procédures… L’on parle de moderniser l’État ; tout le monde s’y accorde mais pour quoi faire ? L’on affirme la nécessité d’éval
La réforme de l'État
Cet article fait partie de la revue Futuribles n° 263, avr. 2001