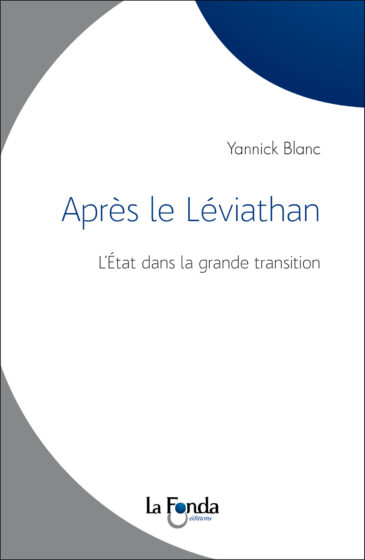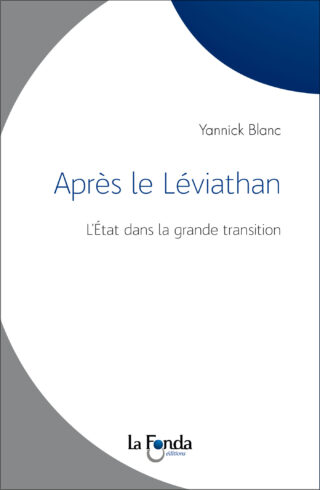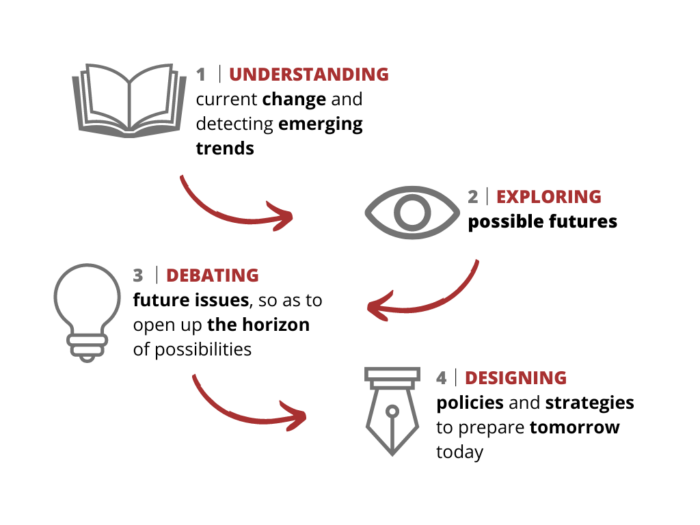Le regard de Yannick Blanc sur l’État « dans la grande transition » est celui d’un intellectuel et d’un prospectiviste, enrichi par l’expérience de l’administration active. L’auteur l’assume d’emblée avec force : « c’est d’une expérience intime et prolongée de l’impuissance publique qu’est venue l’idée de ce livre ». L’auteur rappelle que le Léviathan de Hobbes (1651) était un corps disloqué qu’il s’agissait de refonder à l’issue de 10 ans de guerre civile. Son propre livre n’est pas l’ouvrage d’un conservateur ou d’un nostalgique : il se propose de dégager une logique nouvelle qui permette à l’État de retrouver une légitimité et des moyens d’action, mais dans des conditions adaptées aux données de nos sociétés.
Car cet ouvrage est en quelque sorte l’examen approfondi d’un paradoxe : d’une part, « tout à leur névrose d’échec, les politiques ont conclu de leur incapacité à mouvoir les leviers de l’action publique que ces leviers étaient grippés ou vermoulus », tandis que la dénonciation, en bloc, de l’État, des hauts fonctionnaires, de l’endettement public comme sources de tous les maux – les leçons de la crise financière de 2008 étant vite oubliées – est devenue le mot d’ordre universel. D’autre part, les administrations elles-mêmes n’ont cessé, en parallèle, de vivre sous l’empire de la « réforme » permanente, non sans résultat, mais avec une sorte d’activisme obsessionnel qui pourrait presque s’assimiler à une autre forme de névrose.
Yannick Blanc analyse d’abord la « matrice tutélaire » de l’État moderne, cette armature de notre société qui a fait longtemps reposer la relation entre la puissance publique et l’individu sur un rapport inégal de tutelle qui s’imposait naturellement. Or cette matrice, qui est plus qu’un paradigme, est explicitement en crise, de longue date, avec « la disparition des empires coloniaux, la suppression de la tutelle de l’État sur les collectivités territoriales et les entreprises, la reconnaissance de droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration et plus généralement la prépondérance croissante des droits subjectifs sur la logique de l’ordre public ». Mais il y a aussi, dit-il, l’implicite : perte du monopole de l’expertise juridique et technique des administrations, mise en cause croissante de la responsabilité pénale des décideurs publics, critique récurrente de la légitimité technocratique, dénonciation rituelle de la « complexité ». Cette tendance lourde n’est pas linéaire, elle connaît des périodes de reflux, constate Yannick Blanc, qui indique au passage que si l’administration participe elle-même à cette entreprise de déconstruction, elle conserve aussi ses vieux réflexes quand la nécessité l’impose.
Mais c’est une tendance lourde. De ce point de vue, poursuit-il, les explications classiques de la crise de l’État – les effets conjugués de la décentralisation et de la construction européenne – sont à relativiser, tout comme il faut rendre à leurs justes proportions les conséquences de la prolifération des autorités administratives indépendantes. Il est en revanche plus critique sur l’émergence du new public management qui ne porte pas seulement le coup fatal à la « matrice tutélaire », mais prétend aussi lui substituer un paradigme totalement inadapté. La logique de la performance poussée à l’extrême – surtout depuis la consécration de l’endettement public comme source première de la crise systémique que connaît la France – délégitime l’action de l’État jusque dans les secteurs les plus régaliens, qui sont par nature les plus rebelles à ce qu’Alain Supiot a appelé « la gouvernance par les nombres [1] ».
L’État, donc, comme « médiateur de l’universel », « s’évapore sous nos yeux ». D’où la question angoissante : « et si ce vide se remplissait d’une nouvelle servitude ? » Une servitude portée par la revendication des identités et la concurrence des institutions : car la disparition de la matrice de l’État est à l’origine de la déstabilisation générale de tout le système français de décision, qui n’est plus à même d’exercer la moindre action efficace sur la société. Il faut donc réinventer cette capacité d’agir au moment où les menaces les plus lourdes pèsent sur la vie collective. Se refusant à rejeter le concept de « gouvernance », malgré son lourd passif, Yannick Blanc propose non pas de « refonder », mais de « reconfigurer » l’État à partir des « communautés d’action » dont le cadre est généralement territorial et embrasse une grande diversité d’acteurs, notamment ceux qui agissent sous des formes associatives diverses – selon lui, « le moment associatif est le chaînon manquant de l’anthropologie politique ». L’État, qui reste le garant indispensable de l’ordre public en temps de crise, devra désormais accepter de partager, en quelque sorte, ses pouvoirs d’intervention avec ceux de la société : ce sera « l’emboîtement des institutions ». L’État « régulateur », « investisseur », « intégrateur » retrouvera énergie et légitimité en œuvrant pleinement avec les communautés d’action – pensées comme une sorte d’« échelon intermédiaire entre la poursuite de l’intérêt individuel et la somme complexe des intérêts et des internalités dans la Grande Société ». Yannick Blanc résume ainsi son diagnostic : « Le cœur vivant de la démocratie ne bat pas dans les assemblées représentatives, qui sont cependant des organes vitaux de la régulation, mais dans les instances formelles et informelles où se décide l’action des communautés. »
En fait, notre auteur poursuit, pour l’État, un objectif similaire à celui de Pierre Rosanvallon dans ses ouvrages successifs sur la crise de la démocratie et ses avatars. Selon ce dernier, le système représentatif est même périmé : il serait nécessaire de réinventer, de relégitimer le processus démocratique si l’on veut éviter que prospèrent la « contre-démocratie » et ses dérives. D’une certaine manière, on retrouve là l’obsession de la gauche intelligente : comment empêcher le règne sans partage de l’ultralibéralisme sans pour autant passer pour d’abominables conservateurs, d’affreux étatistes, d’irréductibles nostalgiques de l’État-providence ? Pierre Rosanvallon a trouvé un passage sur le bas-côté, qu’il laisse entrevoir à la fin de La Société des égaux [2] : l’écologie. Yannick Blanc va plus loin, parce qu’il connaît parfaitement l’État, tout en maîtrisant remarquablement les maîtres de la pensée politique. Sa démonstration est passionnante mais suscite toujours cette même question : comment peut-on transformer en institutions efficaces (et donc réellement démocratiques) des « communautés d’action » dont il donne, somme toute, cette seule définition – « la manifestation concrète de l’associativité, la particule élémentaire de l’action collective ».
Mais encore ? La crise de la démocratie et de l’État en France ne serait-elle pas plutôt l’effet d’une perte générale du sens de l’institution dans un pays – la France – qui n’est jamais allé jusqu’au bout de la démocratie représentative et qui n’a longtemps tenu que par un État fort, palliatif obligé de 15 ou 16 régimes constitutionnels successifs ? Yannick Blanc songe à une nouvelle « grammaire commune » dont il serait possible de tirer, à nouveau, les ressources d’une action collective. Mais peut-être avons-nous perdu tout simplement les codes et les règles d’une grammaire des institutions qui n’avait pas donné toute sa mesure et à laquelle nous n’avons pas réellement laissé sa chance. Les circonstances tragiques d’aujourd’hui, et la relecture de Hobbes en parallèle le laisseraient à penser…, ce dont le préfet Yannick Blanc est bien conscient et donne lui-même la mesure par le rajout d’une très significative postface à la fin de son ouvrage, intitulée « raison d’État ».
——————————
[1] Supiot Alain, La Gouvernance par les nombres, Paris : Fayard, 2015.
[2] Paris : Seuil, 2011.