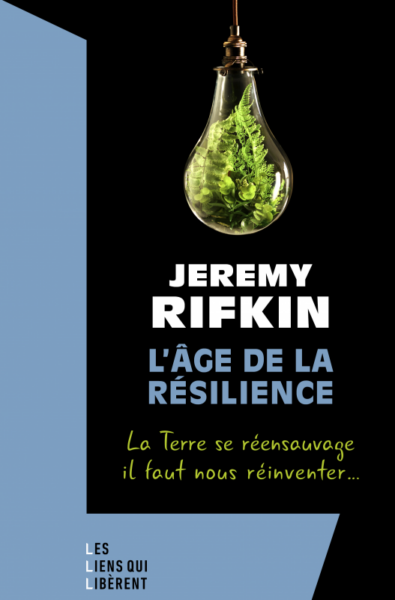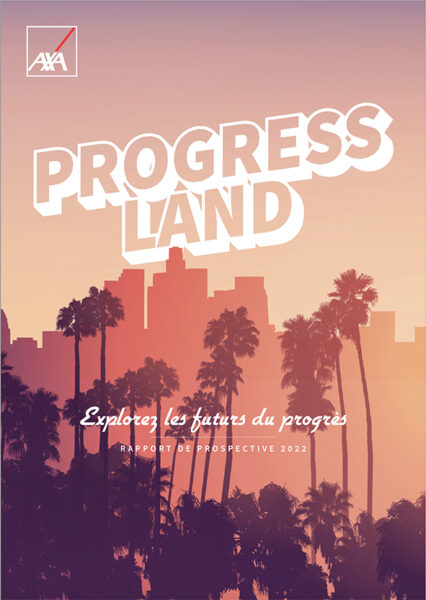L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et les premières mesures qu’il a annoncées depuis son entrée en fonction suscitent une légitime inquiétude et bien des questions. Comment expliquer que la plus grande démocratie du monde (certes à l’exception de l’Inde) tombe de la sorte entre les mains d’un tel démagogue ? Que la première puissance, longtemps gardienne de l’ordre mondial malgré les nombreux revers de sa politique étrangère, devienne ainsi un tel danger sur une scène internationale déjà si explosive ? Cette élection n’est-elle qu’un accident dû au malaise particulier dont souffre la société américaine, ou le signe avant-coureur d’une crise plus profonde, commune aux démocraties occidentales, comme on peut le craindre en voyant dans nombre de pays, notamment européens, prospérer les mouvements populistes ?
Comment expliquer ce phénomène ? Certes, la crise économique et les perspectives de croissance et d’emploi dans les pays occidentaux n’incitent guère à l’optimisme (j’y reviendrai). Les inégalités en termes de revenu et de patrimoine se creusent, l’ascenseur social est en panne et les perspectives, notamment pour les jeunes générations, d’accéder à un niveau de bien-être supérieur à celui de leurs parents, tendent à s’amenuiser. Toutes les structures sociales se fragilisent, deviennent plus précaires, sont sujettes éventuellement à suspicion, sous l’effet de très nombreux facteurs tels que l’individualisme, le culte de l’instantanéité, le caractère réversible de tous les engagements… De tous les maux dont souffrent nos sociétés, je ne saurais ici, en quelques lignes, faire l’analyse. Mais parmi ceux-là intervient en premier lieu le problème de la solidarité et de la confiance, tout particulièrement celle que l’on est supposé pouvoir accorder, dans les pays démocratiques, aux gouvernants.
Le discrédit de ceux-là, notamment en France, n’a jamais été aussi grand. J’y vois une excuse tenant au fait que l’État n’est plus aussi souverain sur son territoire qu’autrefois ; cette tendance est sans doute inéluctable. Mais il y a d’autres raisons, notamment en Europe, à commencer par le fait que la plupart des dirigeants ne sont plus porteurs d’une vision, d’une représentation d’un futur souhaitable, qui soit mobilisatrice et permette de conférer un sens et une cohérence à long terme aux actions collectives. Ils se conduisent en simples gestionnaires des affaires courantes, en privilégiant avant tout leur communication et ce qui peut flatter leur image. Ainsi le peu de crédit qu’ils ont en arrivant au pouvoir est-il rapidement dilapidé, d’abord parce qu’ayant trop fait de promesses contradictoires, celles-ci sont vite oubliées ; ensuite parce que leur posture n’a rien de celle d’un chef d’État.
Qu’en sera-t-il de ceux qui prétendent aujourd’hui à cette fonction suprême, seront-ils davantage porteurs d’une vision politique, voire d’un idéal collectif crédible, ou ne sont-ils eux-mêmes que des saltimbanques en quête simplement du pouvoir, mais sans autre ambition ? Nous avons décidé de publier, dans la revue Futuribles, une série d’articles consacrés à la question de savoir quelles visions à long terme inspirent les politiques. Nous proposons, dans ce numéro, deux premières contributions (celle de Jean-Paul Delevoye et celle de Jean Haëntjens) ; d’autres suivront.
Une autre partie conséquente de ce numéro est consacrée à un phénomène désormais connu sous le terme surprenant de « secular stagnation » qui, aux dires de certains économistes, signifierait que la croissance économique demeurerait durablement ralentie en raison d’une moindre croissance de la productivité. Antonin Bergeaud, Gilbert Cette et Rémy Lecat, d’une part, et Charles du Granrut, d’autre part, après avoir rappelé les différentes définitions de la productivité et le rôle déterminant que celle-ci joue dans la croissance économique, nous livrent une analyse sur longue période (1890-2015) de son évolution dans les principaux pays développés. Ils montrent que, durant presque tout le XXe siècle, celle-ci a augmenté à un rythme élevé, très largement en raison du progrès technique lié à la deuxième révolution industrielle (le moteur à explosion, la mécanisation, l’énergie notamment électrique, les transports, les communications…). En revanche, ils soulignent que depuis une vingtaine d’années, cette croissance de la productivité s’est fortement ralentie.
Cette évolution est surprenante eu égard aux développements si souvent évoqués, depuis 30 ou 40 ans, de l’informatique, suivis de la convergence des technologies et, plus récemment, de l’Internet des objets, de la robotique, des imprimantes 3D, du big data ; en bref, de « la troisième révolution industrielle » chère à Jeremy Rifkin. Que n’a-t-on pas dit et écrit sur cette révolution qui était supposée radicalement transformer nos modes de vie – et qui effectivement l’a fait en partie -, nos entreprises et le monde du travail, y compris en menaçant de détruire une grande part de l’emploi (plusieurs études estimaient, voici encore deux ans, que 50 % des emplois pourraient disparaître, chiffre ramené à moins de 10 % dans des travaux plus récents) ? Pour nous assurer que la macroéconomie n’était pas aveugle aux impacts du numérique dans les entreprises, nous avons demandé à Norbert Girard quels avaient été ses effets dans un secteur supposé particulièrement vulnérable, celui de l’assurance. Le volume d’emplois, nous répond-il, est stable, mais les métiers changent et exigent de nouvelles qualifications.
Alors comment expliquer cette évolution paradoxale ? Plusieurs hypothèses sont avancées dans ce dossier spécial : soit que les gains de productivité ne peuvent plus se mesurer à l’aune des indicateurs comptables actuels, soit que la troisième révolution reste à venir, ou qu’elle n’aura jamais lieu, ou qu’elle entraînera des bouleversements que nul n’anticipe encore.